D’où viennent les religions du monde ? Comment comprendre ces religions d’un point de vue chrétien ? Quelle devrait être notre posture vis-à-vis de l’Autre religieux ? Quel est le lien entre ce dernier et l’Évangile ? Dan Strange se propose de nous donner un cadre biblique pour comprendre et interagir avec l’altérité religieuse sans compromettre l’Évangile de Jésus Christ.
Voici la thèse défendue par Strange concernant les religions du monde :
« En présupposant la révélation biblique comme autorité épistémologique, les religions non-chrétiennes sont des réponses idolâtres et collectives des Hommes face à la révélation divine. Elles sont souverainement dirigées, variées et dynamiques. Derrière elles se tiennent des forces démoniaques trompeuses. Étant antithétiques à la vérité de la vision du monde chrétienne et pourtant dépendantes de manière parasite de cette dernière, les religions non-chrétiennes sont accomplies de manière subversive dans l’Évangile de Jésus Christ. » (42)
Pour démontrer cette thèse, Strange fait un travail remarquable de théologie biblique des religions (ch. 1-6) avant de systématiser ses trouvailles (ch. 7) et de relever des implications missiologiques et pastorales (ch. 8-9).
J’invite le lecteur pressé à sauter directement au point IV qui aborde l’articulation finale de la théologie des religions de Strange.
I. L’Homme religieux : de l’adoration du seul vrai Dieu à l’idolâtrie
Strange commence son exposé en Genèse 1, d’où il tire la distinction fondamentale entre le Créateur et la créature. Il n’y a qu’un seul Dieu ; le reste sont des créatures. Il s’attarde ensuite sur le lien entre le Créateur et la créature. La création, étant créée par Dieu, révèle Dieu. Cela est particulièrement vrai de l’humanité créée à son image. Ce dernier élément signifie, entre autres, que l’Homme est fondamentalement relationnel. Il est créé en relation avec Dieu (relation d’alliance), avec l’humanité et avec le reste de la création auprès de laquelle il doit représenter Dieu, son règne et son travail de création (Gen 1.28). Ainsi, l’Homme est religieux dans son être même en vertu de l’image de Dieu (71). Et cela perdure après la chute1: l’Homme demeure en relation avec Dieu, bien que l’alliance soit violée. Cette réalité ontologique nous permet aussi de comprendre les degrés de continuité que l’on peut observer entre cultures et religions: nous sommes tous fait du même moule religieux. Oui, tout homme est religieux.
La chute nous montre la rupture de la « religion » originelle et l’introduction d’une « fausse foi » (77). En donnant crédit au serpent, Eve, puis Adam, croient en un mensonge concernant Dieu (Gen. 3). La relation avec Dieu est brisée (mais elle ne devient pas inexistante). Ce premier péché est un acte idolâtre en ce qu’il manifeste une distorsion et un déni de l’identité révélée de Dieu (75). Du Dieu bon et vrai qu’il est, il devient un menteur tyrannique. Sous l’influence de Satan, Adam et Eve font le choix de l’auto-détermination en prenant le fruit défendu, espérant ainsi devenir l’égal de Dieu. Il s’agit d’une tentative idolâtre de renverser la distinction entre le Créateur et la créature.
II. La promesse de rédemption, l’antithèse, et la grâce commune
Dieu, dans sa grâce, fait une promesse de rédemption à Adam et Eve qui concerne toute l’humanité (Gen. 3.15). Mais cette promesse introduit également l’antithèse, avec la séparation entre la descendance de la femme et la descendance du serpent (82)2. Cette dernière correspond à l’humanité hostile à Dieu. Une antithèse existe entre les deux descendances en ce qu’une se soumet à l’autorité divine concernant l’interprétation de la réalité, tandis que l’autre suit le mensonge du serpent (84)3. Ainsi, voici deux « orientations fondamentales », ou « visions du monde »4, que tout oppose, ancrées dans les présuppositions les plus fondamentales du cœur. Ainsi « l’antithèse signifie qu’en réalité il n’y a fondamentalement que deux catégories d’êtres humains formant deux ensembles circonscrit » (85). Il n’y a pas de neutralité éthique ou épistémique entre les deux (86).
La doctrine de l’antithèse va de pair avec la doctrine de la grâce commune, qui « limite » ou « complète » la première (86). La grâce commune est une « manifestation non-salvifique de la grâce de Dieu » (87). Elle se manifeste dans la limitation du mal et l’engagement divin de ne pas exécuter immédiatement le jugement final, mais aussi en ce que les incroyants bénéficient de la bonté de Dieu. Ainsi, des non-croyants peuvent être de « bonnes » personnes, connaître des vérités, etc… L’alliance noachique en est l’exemple type (Gen. 8 :21-22 ; 9 :1-17). Cette alliance (et la grâce commune) permet la continuation de l’Histoire, et donc la progression de l’Histoire de la rédemption pour le salut du peuple de Dieu.
Ainsi, on voit que l’Homme est constitué d’un « mélange anthropologique complexe » (91). En principe, l’antithèse rend tout dialogue et cohabitation entre croyant et non-croyant impossible. Mais en réalité, la vision du monde des gens et sa mise en pratique sont souvent inconsistantes (pour les non-croyants comme pour les croyants)5. Cette inconsistance chez les non-croyants s’explique en partie par l’image de Dieu et de la grâce commune (92). Tous demeurent ontologiquement à l’image de Dieu et métaphysiquement dépendants de Dieu. En un sens, tous connaissent Dieu (93 ; Rom. 1.21), bien qu’ils étouffent cette connaissance et ainsi ne le connaissent pas (Rom. 1.18). Et tous sont bénéficiaires de la grâce commune, leur permettant de manifester certaines vertus et de faire le bien dans le monde malgré leur opposition fondamentale à Dieu. Cela permet donc un terrain commun entre croyants et non-croyants, bien que ce terrain n’est en aucun cas neutre (94). Le non-croyant vit donc dans une contradiction permanente : étant à l’image de Dieu mais rejetant Dieu ; vivant dans la réalité de la vision du monde biblique mais adhérant à une vision du monde mensongère.
III. L’idolâtrie dans l’ancien et le nouveau testament (ch. 5-6)
Après une discussion sur l’origine historique des religions (ch. 3-4)6, Strange soutient que « l’idolâtrie est certainement la clé herméneutique pour comprendre la nature de la et les religions non-chrétiennes » (156). Il commence par présenter l’attitude de l’Ancien Testament vis-à-vis de l’altérité religieuse. Du début à la fin, l’Ancien Testament présente Yahweh comme étant transcendentalement unique (lui seul est Dieu) et toute autre religion comme étant fondamentalement idolâtre. Strange interagit avec un nombre de théologiens qui voient dans l’Ancien Testament une posture plus inclusive vis-à-vis d’autres religions, particulièrement à l’époque des patriarches, ou qui pensent que l’Ancien Testament présente simplement Yahweh comme le plus grand parmi un panthéon de dieux. Il présente avec détail leurs arguments avant d’y répondre de manière minutieuse et convaincante.
Mais si l’Ancien Testament défend la divinité exclusive de Yahweh et déclare que face à lui les idoles ne sont rien, elles ne sont néanmoins pas rien d’un point de vue humain. Ainsi, elles sont présentées dans l’Ancien Testament comme étant des constructions humaines qui agissent comme des parasites et des contrefaçons (207). En effet, elles sont tirées de la création créée par Dieu pour donner ce que Yahweh seul peut donner : vie, paix, sécurité. Par conséquent, l’idolâtrie est une offense suprême envers Dieu et conduit toujours à la ruine de ses pratiquants à cause de la futilité des idoles et du jugement divin (209).
Le Nouveau Testament corrobore et développe ce que l’Ancien Testament enseigne sur l’idolâtrie. L’exclusivisme de Yahweh trouve son point focal en Jésus-Christ : il n’y a point d’autre Seigneur ni de salut en dehors de la foi en Christ. Foi qui nécessite de connaître les faits historiques de sa mort et de sa résurrection. Les autres religions sont des réponses idolâtres à la révélation divine et ne peuvent pas sauver.
IV. Une théologie des religions
Le chapitre 7 synthétise toutes les données et explique en détail la thèse de Strange citée en introduction. Si les religions du monde sont fondamentalement idolâtres, il en suit qu’elles sont en opposition antithétique à la révélation divine (240). Il n’y a fondamentalement que deux religions : la foi chrétienne et l’idolâtrie sous diverses formes. Bien qu’il y ait des ressemblances entre le christianisme et d’autres religions, elles ne sont que superficielles car les visions du monde qui sous-tendent ces religions sont radicalement opposées (242). Dire que le christianisme a 90% de choses en communs avec, par exemple l’Islam, n’a donc aucun sens. Même si l’apparence a des similarités, le fond derrière les apparences est radicalement différent.
Pourtant, la nature idolâtre de l’Autre religieux implique une contrefaçon de la révélation divine et donc une dépendance à cette dernière (246), avec des similarités « structurelles » ou « formelles » (246) avec le christianisme. En fait, l’Homme idolâtre ne crée rien de nouveau, mais ne fait qu’imiter la vérité divine. Ainsi, toute vision du monde dépend, dans sa structure même, de la vision du monde biblique (247). C’est pourquoi, toute religion/vision du monde a sa propre histoire de commencement / chute / rédemption / consommation : c’est l’Histoire du monde, on ne peut y échapper. Toute religion a donc une structure similaire en lien avec les questions que l’humanité se pose perpétuellement, ce que J.H. Bavink appelle le « quoi » de la religion7. La différence radicale et incommensurable se trouve dans la réponse à ces questions : le « ça » de la religion (250). Les réponses apportées par l’Autre religieux sont idolâtres, donc fausses et incapables de sauver.
Derrière ces réponses idolâtres se trouvent l’influence de démons. La Bible en parle peu, mais on peut distinguer certains de leurs modes opératoires en ce qui concerne l’idolâtrie. Ils « cooptent » les idoles (264): ils demeurent distincts des idoles, mais peuvent leur donner « vie » en agissant en leur nom. Ceux qui adorent ces idoles entrent sous la sphère d’influence de ces démons8. Ces derniers peuvent également être la source de révélations sur lesquelles ces religions se construisent (258).
Puisque les religions sont une corruption de la révélation divine et ne peuvent tenir leurs promesses, l’Évangile de Christ est leur « accomplissement subversif » (266). L’Évangile est d’abord subversif en ce qu’il ne vient pas ajouter ou compléter l’Autre religieux, mais le condamner et le renverser. L’Autre religieux ne conduit jamais naturellement à l’Évangile ou à Christ (comme une preparatio evangelica). Le « ça » de l’Évangile subvertit le « ça » de l’autre religieux. Mais le « ça » de l’Évangile accomplit le « quoi » de l’Autre religieux. En effet, l’Évangile seul peut assouvir les soupirs de l’Homme exprimés dans les religions et répondre de manière satisfaisante à ses questions et aspirations les plus profondes.
Dans les deux derniers chapitres, Strange soulève brièvement des implications pratiques de sa théologie des religions pour l’évangélisation et la mission (ch. 8) et des perspectives pastorales sur la finalité de l’Autre religieux dans le plan de Dieu. L’exemple contemporain de « l’accomplissement subversif » avec le sunnisme (islam) est particulièrement instructif (294-300). Pour voir la mise en œuvre pratique de ce modèle dans l’évangélisation, je renvoie le lecteur vers deux ouvrages plus populaires de Strange : « Chrétien dans la culture d’aujourd’hui » et « Making Faith Magnetic » (non-traduit à ce jour) qui élaborent les points de contact entre l’Évangile et la culture occidentale.
Réflexions
L’ouvrage de Strange est intellectuellement rigoureux, et fiable d’un point de vue exégétique. Dans une époque pluraliste où la tentation de mettre l’Évangile et les autres religions sur le même plan se fait sentir, il nous rappelle le caractère unique et exclusif de l’Évangile. De plus, cette théologie des religions rend compte de manière satisfaisante du phénomène religieux, notamment par le concept clé d’idolâtrie, et corrige ainsi toute vision romantique que l’on peut se faire des religions du monde. Elle donne également un cadre biblique et théologique pour interagir avec l’Autre religieux, qui souligne à la fois la différence radicale de l’Évangile avec ce dernier, tout en permettant des points de contact (ou d’attaque, p282) entre les deux. Ainsi, il jette des bases solides pour une mission efficace, maintenant l’intégrité de l’Évangile tout en ayant la capacité de communiquer l’Évangile à l’Autre religieux avec persuasion.
Comblant un vide dans la théologie évangélique contemporaine, Strange puise avec brio dans la tradition Réformée, particulièrement néerlandaise. Il permet ainsi de faire remonter à la surface et de populariser la pensée des missiologistes J.H. Bavink et Hendrik Kraemer qui méritent d’être connus et étudiés (en particulier Bavink).
Leur roc n’est pas comme notre Roc est un ouvrage à lire pour toute personne se formant à la mission. En effet, bien qu’il n’est pas orienté pratique, il donne un cadre biblique et théologique nécessaire à une pratique saine et biblique dans l’interaction avec l’Autre religieux. C’est également un ouvrage précieux dans un monde globalisé où la confrontation avec l’Autre religieux est plus fréquente et peut interpeller et questionner la place de l’Évangile dans le supermarché des religions.
En bref, un ouvrage dense qui apporte des réponses rigoureuses sur la question de l’existence et de la persistance de l’Autre religieux et de sa relation à l’Évangile.
Strange, Daniel. “For Their Rock Is Not As Our Rock”: An Evangelical Theology of Religions. 1st ed. London: Inter-Varsity Press, 2014.
- Bien qu’il y ait une forte rupture éthique et épistémologique, l’image de Dieu demeure présente structurellement et métaphysiquement (71). ↩︎
- L’antithèse est un terme technique en théologie réformée pour parler de la différence radicale entre croyants et incroyants (82). ↩︎
- Dans la suite de la Genèse, Caïn et sa lignée représente la descendance du serpent, tandis que Seth et sa lignée représente la descendance de la femme. Ce thème se poursuit tout au long de l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau Testament (cf. Jean 8.44). ↩︎
- Pour une introduction au concept de « vision du monde », voir l’article La vision du monde chrétienne, Raphaël Charrier
↩︎ - Par exemple, les matérialistes (ceux qui nient toute réalité au-delà du matériel) ne nieront que rarement l’importance de ne pas faire de mal aux autres, bien que rien dans une vision du monde matérialiste ne peut justifier un tel positionnement éthique. ↩︎
- Strange défend la thèse d’un monogénisme des religions (ou théorie d’une source unique) et avance que la diversité des religions tire son origine de l’après tour de Babel. Ces chapitres sont laborieux, bien qu’intéressants, je me permets de les sauter car ils ne sont pas essentiels à la thèse de son livre. ↩︎
- J.H. Bavink les classifie en 5 points magnétiques : la place de l’Homme de l’univers, l’intuition d’une norme transcendante, l’intuition que l’existence est dirigée par une puissance providentielle, la reconnaissance d’un besoin de rédemption, l’intuition d’être relié à un être ou une puissance supérieure (252, voir aussi « The Church between Temple and Mosque », J.H. Bavink et « Making Faith Magnetic », Dan Strange, qui reprend le modèle de Bavink pour la culture actuelle). ↩︎
- 1 Co. 8.4-5 ; 10 :18-32 ; 2 Co. 11.13-15a ; Strange s’appuie notamment sur le travail de Mody: “Empty and Evil : the Worship of other Faiths in 1 Corinthians 8-10 and Today”. ↩︎
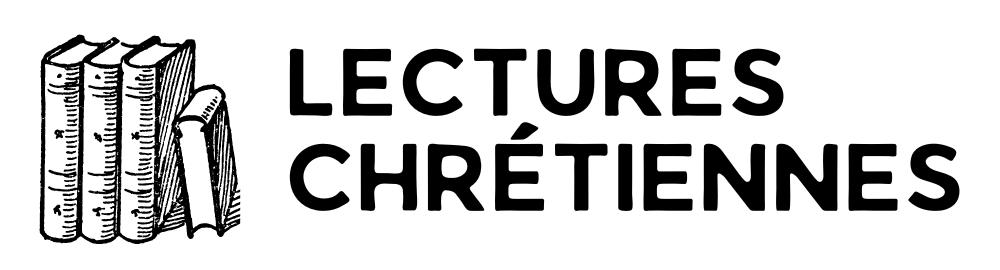
Les commentaires sont fermés.